[REVUE DE PRESSE] Cor, de Lionel-Édouard Martin : Variations autour du même LEM par Marc Villemain 10 septembre 2018 – Publié dans : La revue de presse – Mots-clés : Lionel-Édouard Martin, Marc Villemain
Merci à Marc Villemain pour cette lecture du Cor de Lionel-Édouard Martin. Chronique à retrouver ici et livre à se procurer là.
—
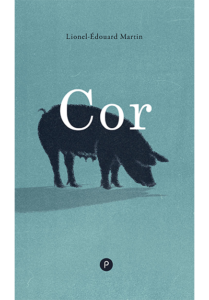 Il en va toujours ainsi, avec Lionel-Édouard Martin : livres après livres, on continue de se surprendre à le lire comme si c'était la première fois. Mais qu'est-ce donc qui change, d'un roman l'autre ? Fondamentalement, rien. Arrimé à une composition ingénieuse, le lexique reste toujours aussi enchanteur, argotique et savant, d'une justesse presque maniaque, ancré dans des âges plus ou moins (plutôt plus que moins) révolus mais déployant une jolie propension au volage et au facétieux - entendez une belle liberté. C'est le lexique d'une langue au tempérament poétique enserrée dans une syntaxe soucieuse des accents et des accidents de l'oralité, où la phrase longue fait résonance au balbutiement du parler humain ; à cette aune, on aurait presque envie d'y entendre des manières à la Christian Gailly, quoique chez LEM la phrase soit toujours plus luxuriante, plus riche - comme on le dirait d'un mets. Il n'est pas interdit non plus d'invoquer Maupassant : si le Haut-Poitou martinien remplace la Normandie maupassantienne, on retrouve surtout chez Martin le même refus du naturalisme, le même souci de sublimer un réalisme toujours plus ou moins illusoire et, pour lui préférer l'éclairage des seuls actes humains, la même défiance envers l'explication psychologique. Quant aux prétextes dont il nourrit ses histoires, là non plus, guère de surprises à attendre : quelques caractères esseulés au sein d'un peuple de braves gens habités par leurs habitudes, de complexion plutôt taciturne, la sentimentalité muselée à de vieilles pudeurs ; et d'extractions volontiers rurales, même si LEM ne déteste jamais quelques intrusions dans le petit peuple des villes ou chez les titis parisiens - on songera, parmi quelques autres, au très beau Mousseline et ses doubles.
Il en va toujours ainsi, avec Lionel-Édouard Martin : livres après livres, on continue de se surprendre à le lire comme si c'était la première fois. Mais qu'est-ce donc qui change, d'un roman l'autre ? Fondamentalement, rien. Arrimé à une composition ingénieuse, le lexique reste toujours aussi enchanteur, argotique et savant, d'une justesse presque maniaque, ancré dans des âges plus ou moins (plutôt plus que moins) révolus mais déployant une jolie propension au volage et au facétieux - entendez une belle liberté. C'est le lexique d'une langue au tempérament poétique enserrée dans une syntaxe soucieuse des accents et des accidents de l'oralité, où la phrase longue fait résonance au balbutiement du parler humain ; à cette aune, on aurait presque envie d'y entendre des manières à la Christian Gailly, quoique chez LEM la phrase soit toujours plus luxuriante, plus riche - comme on le dirait d'un mets. Il n'est pas interdit non plus d'invoquer Maupassant : si le Haut-Poitou martinien remplace la Normandie maupassantienne, on retrouve surtout chez Martin le même refus du naturalisme, le même souci de sublimer un réalisme toujours plus ou moins illusoire et, pour lui préférer l'éclairage des seuls actes humains, la même défiance envers l'explication psychologique. Quant aux prétextes dont il nourrit ses histoires, là non plus, guère de surprises à attendre : quelques caractères esseulés au sein d'un peuple de braves gens habités par leurs habitudes, de complexion plutôt taciturne, la sentimentalité muselée à de vieilles pudeurs ; et d'extractions volontiers rurales, même si LEM ne déteste jamais quelques intrusions dans le petit peuple des villes ou chez les titis parisiens - on songera, parmi quelques autres, au très beau Mousseline et ses doubles.
Non, décidément, l'univers de Lionel-Édouard Martin n'évolue que par variations infimes, légers glissements de la focale, dans un jeu conscient de ressassements profonds. Pourtant ce qui nous trouble, alors que lui-même parfois se dit si réticent à poursuivre dans la veine romanesque, c'est ce talent qu'il a, que l'on pourrait croire inné tant on se coule d'évidence dans cette écriture joueuse, onduleuse et bosselée, de nous entraîner dans des vies. Oh, des vies de pas grand-chose, à l'image de celles de Cor et de Clarinette (ils tiennent leurs surnoms de leur appartenance à l'Harmonie municipale), lui entouré de ses cochons (on est, dans sa famille, « marchand de porcs de père en fils »), elle mariée à un type du genre teigneux, et jaloux par-dessus le marché, qui ne tardera pas à mériter son surnom de « Toréador ».
La musique étant affaire de sens, c'est bien une sensualité d'un type nouveau, pour Cor en tout cas, qu'elle fera naître chez ces deux-là, et c'est à cette histoire d'amour - puisque c'en est une - que Lionel-Édouard Martin va donner un tour passionnel, jusqu'à lui conférer quelques élans érotiques plutôt rares dans son œuvre ; mais ne nous emballons pas : rien de fougueux en ce monde où l'amour - le mot et la chose - a tout de l'insolite : on approche moins l'autre qu'on ne l'apprivoise, par petites touches et infimes pudeurs, avec comme qui dirait des gestes de vieux paysan. C'est un monde où la propriété est inaliénable et chaque territoire marqué : ça ne se fait pas de convoiter le bien de l'autre. Mais voilà,
Cor n'a rien fait pour.
Clarinette non plus n'est pas responsable.
Ça devait venir, c'est venu.
Car l'amour est un destin. Cor aurait bien pu s'accommoder de vivre sans, comme tant d'autres, mais une fois que le sentiment a pris racine et s'est rendu maître de ses terres, peut-on seulement vivre sans lui ? Cor s'en tient donc d'abord à ce que la décence ordonne - il zieute, mate, rêvasse, fantasme -, mais c'est toujours dans la pure innocence que viennent se loger les malices de l'amour.
Il faut les deux mains, facile, de Clarinette pour faire une main de Cor, d'ailleurs un soir il le lui dit Vos deux mains font à peine une des miennes, Voyons qu'on mesure, elle dit, pose ses mains côte à côte dans la paume de Cor, Non, ça déborde un peu, même en rentrant les pouces, Arrêtez, ça chatouille et ça doit l'amuser de lui chatouiller la paume en remuant les pouces, elle rit, Cor pose son autre main sur les deux mains de Clarinette, Greli-grelo, combien j'ai de mains dans mon sabot ?
Et si cor entre bien sûr en écho avec porc, si les deux, l'instrument comme l'animal, pâtissent d'une réputation comparable de rusticité, l'un paraissant aussi rudimentaire et vieillot que l'autre est sommaire et antique, l'instrument devient ici ce qui allège l'existence, l'ennoblit, teintant l'âme de Cor d'une délicatesse à laquelle peu de choses le destinaient.
Ils ont même leur chanson, leur hymne à l'amour, qui pour tromper la surveillance du légitime peut se faire messager :
Quand elle se campe, désormais, dans la cour, au beau milieu de la cour de la Chasseigne et qu'elle joue - quand donc elle joue cette mélodie Deux petits chaussons de satin blanc, ça veut dire qu'elle est seule ; que son homme est allé faire à vélomoteur des courses, qu'il n'est pas prêt de revenir ; qu'elle est seule assez longtemps pour.
Le vent, d'où qu'il vienne - puisqu'à vol d'oiseau les deux fermes sont peu distantes -, porte l'air jusqu'au Martreuil. Quand il pleut, qu'il est libre - il tâche de l'être toujours -, il lui répond, jouant au cor la même mélodie, même tonalité, cherchant l'unisson quelque part dans le ciel. Ça ne dure guère, bien vite il enfourche sa mobylette.
Notons au passage qu'au fil de ses textes Lionel-Édouard Martin rechigne de moins en moins à nommer les lieux réels, et que leur périmètre n'en finit pas de se resserrer. On est ici à Lussac, à la Chasseigne, au Martreuil ou à la Trimouille, en ces lieux-dits mais presque anonymes en lisière de « Montmo », la sous-préfecture, dont l'apocope obstinée pourrait être comme le signe d'un ultime hommage au romanesque, une ultime résistance avant que roman et récit ne finissent par se recouvrir l'un, l'autre.
Mais l'amour ne vaut et ne se mesure que dans la durée - donc dans l'épreuve, que ni Clarinette, ni Cor ne cherchent à surmonter. Ils font mieux : ils acceptent leur sort. Ils ont joué, ils payent. Ils ont couru le risque, ils assument. Mais s'ils se résignent au silence, s'ils consentent à l'esseulement, peut-être finalement est-ce cela qui rend leur amour inoxydable. Et cette sombreur alors qui envahit le récit achève de donner à leur amour une aura et une souveraineté miraculeuses. L'amour est devenu ce pour quoi la vie vaut d'être vécue - et tant pis si elle s'y oppose. Rien n'est plus faux pour ces deux-là que l'adage selon lequel le cœur ne saurait résister à l'éloignement du regard, et cet absolu viscéral nous laisse de Cor une impression de conte, qu'étaye la sécheresse d'une chute dont le pouvoir n'est pas moins tranchant que son lyrisme est déchirant.
