[REVUE DE PRESSE] Courir vers l’Est à perdre haleine (par la librairie Charybde) 25 avril 2017 – Publié dans : La revue de presse – Mots-clés : la machine ronde, librairie charybde, notre est lointain, sébastien ménard
Merci à Hughes, de la librairie Charybde, pour cette nouvelle belle chronique (les autres à retrouver ici ou sur le blog de la librairie) autour du travail de Sébastien Ménard.
Courir vers l’Est à perdre haleine, en chassant les mythes de rencontre et les images en soi.
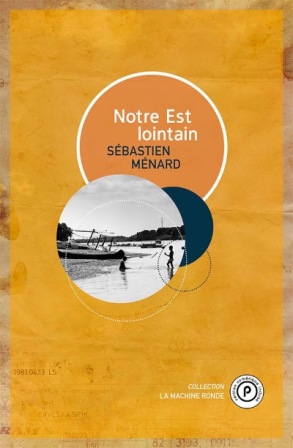
L’histoire que je porte ne connaît ni virgule ni ponctuation. Elle se dessine dans nos têtes le matin. C’est la petite phrase qu’on entend encore – celle qu’on a en bouche lorsqu’il s’agit de prendre la route de nos jobs et qu’on sent les herbes fraîches. Et même pas le temps de courir pieds nus ! De jeter ses fringues une à une en riant – en riant ! Se rouler nu dans l’herbe. C’est ça. C’est vraiment ça. L’histoire que je porte relit chaque livre – recopie les breaks les marges et les images. Elle copie les images restées là dans l’œil ou dans l’oreille. L’histoire que je porte est un son – et ça résonne et ça nous crie dans le corps. L’histoire que je porte pourrait déclamer son monde de poussières debout sur le col de Borşa – sous les pluies froides d’un orage d’été – au milieu d’un boulevard du gasoil et des immondices. Et on entendrait au loin les vaches meugler. Et on entendrait au loin une bagnole étouffer sur le bitume. Des corps l’un contre l’autre. Des rires. Des chiens. Ce serait le son de l’histoire que je porte. Et puis à la fin – quand on aura passé les montagnes et les langues – on s’assurera que cette histoire n’existe pas. On consultera les registres – les carnets et les bouches de nos héros. F. avait-il déjà dit : bougeons sans cesse – bougeons tout le temps – changeons chaque jour chaque matin ? Personne n’a-t-il jamais demandé : pourquoi t’écris comme ça ? Et si jamais on trouvait quelqu’un pour l’avoir dit – est-ce qu’on ne tremblerait pas un peu en avouant que l’histoire que je porte c’est celle-ci – exactement celle-ci ? Alors on fermerait les livres. On fermerait tout. La porte de nos cabanes. Les lieux qu’on n’a pas. La caravane de nos songeries. Les cartons – les microphones et les portes. Alors ce serait le début de la quête du héros moderne. Le début des routes. Le début des soleils qui tombent sur les herbes jaune jaune. Les pluies sur nos peaux. Les matins dans les bois. Et les nuits dehors.
Sébastien Ménard nous avait enchantés et conquis avec son « Soleil Gasoil » de 2015, folie routarde méditerranéenne placée sous le triple signe de la poussière, du carburant et de la viande grillée, bouillonnant d’une langue incomparable. Il nous revient en ce mois d’avril 2017, toujours dans la collection La Machine ronde de publie.net, avec deux ouvrages jumeaux, le deuxième, « Notre désir de tendresse est infini », se présentant comme la version déclamatoire du premier, « Notre Est lointain », qui en serait, lui, une version course-poursuite.
Alors on avait voulu rouler sur les routes de l’Europe.
Quitter nos cabanes – nos baraques et nos territoires.
Toutes ces histoires d’ours – de mecs qui prennent la route la nuit dans la neige – toutes ces histoires de poussière de poème d’eau-de-vie et de feu qu’on allume – c’était quoi alors ?
On avait voulu parcourir les États – traverser les États. On avait voulu rouler – comme ça – sans savoir autre chose que les bords de nos mondes – les bouts de nos plaines – sans chercher autre chose que le nom des sommets – le nom des fleuves – le nom des routes – le nom des Hommes – celui des bêtes.
Voir les eaux de l’Europe s’écouler – suivre des fleuves – écouter les flottes les embarcations les rades et les rafiots. On voulait vérifier que tout était vrai – tout était là – vraiment là.r

Borșa (Matamureș)
Nul besoin d’enseignement de la ferveur dans ces nourritures terrestres-ci : elle est déjà là, omniprésente et comme perpétuellement ragaillardie par la tentation et par la réalisation de ces courses folles aux confins orientaux de l’Europe, courses qui habitent tout l’espace de l’ouvrage, en préparation et en action, et même si la définition exacte de ces zones frontalières variera avec chaque interlocuteur rencontré ou imaginé. En ces terres imprécises où flotte l’esprit brutalement anthropologique des « Gens des confins »d’Irene Van der Linde et de Nicole Segers ou le voile presque onirique sous le réalisme foncier des « Dernières nouvelles d’Œsthrénie » d’Anne-Sylvie Salzman, ces jeunes gens, empoignant leurs guimbardes fatiguées, leurs vélos ou leurs sacs frugaux, sont lancés sans le moindre froid aux yeux à la conquête d’un réel et d’un imaginaire, qu’il s’agisse pour cela de plonger nu dans quelque Danube, quelque Save ou quelque Someș, d’improviser les légumes grillés qui rapprochent les sans-confort de toutes origines, ou de danser sur les tables renversantes d’un festival de cuivres.
Je ne prends plus de notes. Je ne déclenche plus. On parle peu. De moins en moins. Puis tout repart. Et l’écran diffuse toujours une série ou un jeu télévisé. La tête de sanglier n’a pas bougé. C’est brume et néon blanc. Les murs sont verts. Clopes. Cendriers. Pluies dehors qu’on entend sur les vitres. On danse. Qui a commencé ? Qui s’est levé ? Une femme dit : les gens vous aiment car vous savez faire la fête comme si vous aviez fait la guerre. Embrassades. n’importe quoi. Ça tourne dingue. Tout le monde comprend qu’il est temps de filer.

Aux accents de Jack Kerouac et d’Hubert-Félix Thiéfaine, d’Allen Ginsberg et de Boban Marković, de Richard Brautigan et de Gogol Bordello, semblant se démultiplier entre de possibles Portes de Fer issues du formidable « Last and Lost » et de bien réelles estrades de Guča ou d’ailleurs, une mythologie contemporaine se forge et se reforge inlassablement ici, prenant selon les moments des camouflages liturgiques dignes de Saint-John Perse (« On ne quitte pas le temps des viandes comme ça ») ou des raccourcis souverains échappés d’une improvisation poétique affranchie de sa prise de note et de sa photographie, pour ne plus exister que dans l’instant, l’envolée et la projection. « Texte tribal » ou « chasse aux mythes sur les routes de l’Est », comme le dit fort justement Mahigan Lepage dans sa précieuse postface, « Notre Est lointain » est écrit, chanté et haleté tout d’un souffle fiévreux, et Sébastien Ménard confirme ici avec éclat qu’il est bien en train d’inventer, page après page, une autre littérature de voyage, une curieuse épopée de l’élan et de l’espérance contre toutes attentes.
Ceux qui portent un masque de l’Est. Un soir. Un jour. Un matin. Qu’importe sauf mettre le masque. Qu’est-ce qu’un masque de l’Est ? Qui pour dire d’un masque : c’est un masque de l’Est ? Qui pour attendre à l’ombre d’un arbre et au bord d’une route – voir surgir les masques de l’Est ? Comment l’entretenir ? Le conserver ?
Quelques secondes s’écoulent. Des nez rouges. Des cloches. Des bouteilles en plastique. Des corps. Mouvements. Un cheval file – galop sur l’asphalte.
Alors les héros avaient mis leurs masques de l’Est. Leurs suées de l’Est. Leurs jambes de l’Est. Leurs peaux. Leurs corps. Ils couraient dans leurs rêves de l’Est comme il leur arrive de courir la nuit et yeux fermés. Personne pour vérifier leurs chemins – leurs mondes. Personne pour nommer leurs quêtes. Moi pareil – j’avais mis le masque. Et on fonçait dans la nuit. Quelqu’un dit qu’un masque de l’Est – ça n’a pas de sens. Pourtant : personne pour dire qu’il fallait croire nos masques. Ainsi les héros avaient leurs masques de l’Est sur leurs gueules et corps. Ils étaient debout. Ils tenaient des histoires terribles et sauvages. Ils attendaient la fin d’une nuit. Le début d’un matin. Ils voulaient savoir – la suite – « La passation des pleins pouvoirs de la nuit au petit jour ». Ils voulaient vérifier que leurs masques allaient tenir une aube – et des rêves.
