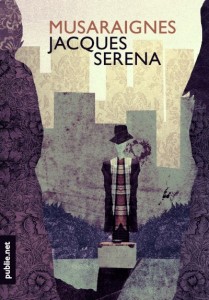Un texte/Une voix — Musaraignes/Jacques Serena 13 octobre 2013 – Publié dans : Un texte/Une voix – Mots-clés : Dostoïevski, Elles en premier toujours, jacques serena, La Sortante, Les Carnets du sous-sol, Michel Massi, musaraignes, Wagon
[read_later_buttons kindle instapaper pocket readlater]
Aujourd'hui, dans Un texte/Une voix, c'est Jacques Serena qui a la gentillesse de répondre à nos trois questions fatidiques autour du texte Musaraignes.
C'est une situation dont j'ai été témoin, une amie artiste, alors sexagénaire, possédant une grande maison, qui hébergeait un homme plus jeune, espèce de poète local, qui passait ses journées à attendre l'inspiration.
Si Musaraignes était une personne ou un personnage, qui serait-il ?
J'ai souvent en tête l'homme des Carnets du sous-sol, de Dostoïevski, qui se conduit odieusement mais inspire la compassion, qui mord parfois pour ne pas pleurer.
Quel passage/mot/extrait de Musaraignes vous tient le plus à cœur et pourquoi ?
Le passage qui me reste cher, après-coup, (je ne relis pas exprès), c'est quand le type se rend compte qu'on lui donne à manger dans un vide-poches et pense jouer un bon tour en mangeant stoïquement dedans comme si de rien n'était.
[divider style="dotted" height="40px" ]
Les premières lignes du texte
Quoi encore. Quelqu'un pour moi, on dirait. Trop tôt pour moi de toute façon, et je suis fatigué. Et à quoi bon me prêter encore à ce genre de visite. Et par-dessus le marché je ne comprends pas cette silhouette assise là au pied de mon lit. Vêtue d'un tailleur, foulard autour du cou. Visage un peu congestionné par le microclimat qui règne en permanence dans ma chambre. Je ne vois pas le motif d'une visite, pourquoi on viendrait, aurait envie, ou besoin, de venir me voir. Comme s'ils avaient besoin d'un prétexte. Ce doit quand même être assez important, j'ai bien senti qu'on a secoué mon mollet plusieurs fois, trois fois au moins depuis que j'en ai pris conscience. Et à peu près autant je pense avant que j'admette le fait. Pour que j'admette un fait il faut ça, bien ça.
On voit mal il faut dire, du fait que je ne veux pas allumer. Et pas qu'on allume, à cause du cauchemar des factures. Même si ce n'est pas moi qui les acquitte, plus moi depuis longtemps qui paie, manquerait plus que ça, mais le pli est pris, à vie, pour ce qu'il en reste. Et de tout l'hiver par exemple je n'allume pas le chauffage non plus dans ma chambre, voilà comment je suis, toute la journée avec ma veste l'hiver, mais bon. Mon œil s'attarde sur le visage, et évidemment je commence à me dire que si je voulais je pourrais le connaître, ce visage. Visage de fille, parce que oui, ça a tout d'une fille. La reconnaître donc cette fille, d'un autre temps, confus, lointain. Pas forcément si lointain. Fille en tailleur. Elle a aussi un béret noir, assez large.
Il se peut, il est même plus que probable, et de plus en plus même, si je veux, que j'ai souvent par le passé vu ce visage sans béret noir. Cette coiffe est gênante, de ce genre qui semble inséparable du visage, on jurerait qu'ils ont poussé ensemble. Mais en fait le tailleur et le foulard sont aussi gênants, autant. D'après moi je devais connaître peu de filles en tailleur et foulard, et encore moins en tailleur, foulard, béret, et cheveux mi-longs de cette jolie teinte mordorée. Les filles mordorées en tailleur et foulard que j'ai dû voir ça a dû être derrière des guichets. Elles ne devaient pas venir s'asseoir au pied de mon lit pour me secouer le mollet. Plus ça va et plus bien sûr je dois me dire que j'ai vu cette fille sans le foulard, sans le tailleur, sans rien. C'est plus que probable vu la façon dont en me fixant ses yeux s'embuent, cherchent à me refiler leur problème. Me faire partager leur émotion. Me persuader d'une imputabilité. Me mouiller dans l'affaire. Cent façons de le dire. Ça ne change rien au fait que si on les a laissées ôter en notre présence leur tailleur elles se croient autorisées à venir, quand bon leur semble, s'asseoir au pied de notre lit secouer nos mollets. Mais c'est maintenant visible, elle commence à sentir que c'est inutile, avec moi, désormais. Qu'elle me fixe en vain, empire son regard pour rien, perd son temps. Ne m'aura pas, ou plus, si elle m'avait eu, ou m'avait laissé l'avoir, c'est pareil, pareil, disons si on s'était réciproquement eus, comme probablement. Elle doit se rendre compte qu'on ne m'aura plus. Et peut-être se dire déjà aussi qu'on ne perdra pas grand-chose. Que de toute façon je suis tout à fait capable de rester là comme ça tout le temps qu'il faudra à la regarder me regarder. Capable de dépérir ici tranquillement immobile en silence. Devenir un squelette couché face à son squelette assis. Enfin, à un moment elle finit par hocher la tête. Se lève. Et sort, de mon champ visuel. Et certainement de ma chambre. Un an et des poussières, je dirais. Peut-être moins, en tout cas pas plus, ou guère plus. Avec cette fille j'ai pu vivre un an environ. Surtout enfermé j'ai vécu avec elle. Même au début, pique-nique sur le lit, téléphone décroché, des jours entiers sans mettre le nez dehors. Quelquefois un cinéma, le lundi dans l'après-midi, et éventuellement un cornet vanille fraise au coin de la rue, ou vanille citron. Quelques courses, pâtes, bière, avocats, boîtes de thon, et retour à la maison. À un moment j'ai même été voir pour des places, qu'elle m'avait trouvées. Pas beaucoup, pas longtemps. Pour la plupart ça n'a pas été plus loin que l'entrevue. On m'expliquait de quel sale boulot mal payé il s'agissait, on me demandait si je voulais l'adresse, je disais oui, ils ne me croyaient pas. Je devais avoir l'air d'être trop sensé pour y aller. Ou à la rigueur le troisième jour je tombais malade.
Elle a alors trouvé pour elle. J'avais fait observer qu'elle avait, elle, une bonne santé, des diplômes, qu'elle avait la manière, plaisait davantage, pouvait escompter des emplois plus intéressants. Je pensais qu'elle ne s'y ferait pas. Je l'avais mal jaugée, elle s'y est faite, incroyablement vite. Elle avait vraiment la manière, elle me sidérait, je ne manquais pas de le lui dire. En quelques mois elle est devenue quelque chose comme consultante, conseillère, dans ce goût-là. Et jamais un rhume.
Je l'attendais à la maison. La grande maison que nous avions alors. Qu'elle avait elle en fait, détail qui aura son importance, qu'elle avait déjà elle avant que je vienne habiter chez elle. Je m'étais, je dois dire, fait à cette maison. Où je l'attendais elle toute la journée. Je m'étais bien fait à la maison sans elle. À l'attendre. Je ne m'ennuyais pas, ai toujours été de cette nature commode, à ne jamais m'ennuyer. Pouvoir simplement me promener de pièce en pièce me suffisait, en slip et sweat, chanter, des blues que je ne connaissais pas. Ou regarder, de temps à autre, ma collection de photos, si je voulais, rien d'obligé. J'aimais bien regarder. À un moment ou à un autre j'envisageais de changer la table de place. Ou le lit, ou la couleur des murs. Ou ajouter une petite étagère, à l'occasion, aux deux d'origine, penser à lui en parler, à elle, à l'occasion. Mais j'oubliais, ou l'occasion ne se présentait pas, comment savoir. Ce dont je suis sûr c'est que quelquefois, les matins, j'envisageais des choses de ce genre, et parfois l'après-midi même. Le fait est que je préférais la maison sans elle. Je ne vois pas pourquoi je le nierai. D'autant que seul à la maison j'arrivais mieux à penser à elle. J'avais évidemment tout l'espace, tout le temps. Et c'est à elle hors de la maison que souvent je pensais. À ce qu'elle pouvait faire hors d'ici. Tout ce qu'elle pouvait, la garce. Ce que je ne lui faisais déjà plus, soit dit en passant. Mais c'est que moi l'occasion ne se présentait pas. Ou j'oubliais. Je n'y pensais en fait que quand elle débarrassait le plancher.
Dans la soirée elle rentrait, en trombe, jetait son béret, sa veste, salut, et tout de suite direction la salle de bains. Et elle y restait longtemps. Bruits d'eau. Robinets. Et bruits de faïence heurtée, et de flacons, et eau à nouveau. Et encore, et encore, bruits, bruits. Et après dans la cuisine. Bruits encore plus absurdes, plus vigoureux, plus agaçants, comme elles savent en faire, eau, robinets, vaisselle, eau. Etc., etc. Tout cet interminable petit tintamarre horripilant pour finalement exhiber quelques pâtes, ou salades, ou épis de maïs. Et elle allumait la télévision, un buste venait annoncer les nouveaux amendements, toujours pareil, toujours pire. Pathétique, voilà le mot, pas tant le fait que les mesures soient si balourdement infâmes, mais qu'ils veillent toujours absolument leur donner les dehors de l'équité lucide, bref. De toute façon dès qu'elle entrait dans la maison, la maison me dépitait, ce n'était plus la maison, j'aimais autant ne pas voir, faisais semblant de dormir, ou que peu s'en fallait.
Le matin je la laissais se lever, ouvrir, fermer trente-six fois la penderie, ses tiroirs, et après faire couler ses robinets, et après y aller de son tapage dans la cuisine, on croit qu'on s'y habituera, et non, au contraire. Et enfin elle partait, à son travail. Et c'est alors que commençait ma journée. Qui consistait surtout à comme j'ai dit marcher dans la maison, en pensant à cette fille. Changer de pièce quand j'avais envie, pas trop souvent. Ou faire des collages pour ses cassettes, ça j'aimais bien, en faire, en refaire. C'était par périodes, avec un stick de colle, des ciseaux et ma pile de vieux magazines. Ou d'autres activités du même genre, créatives la plupart du temps, tout en pensant à elle.
[button link="http://librairie.publie.net/fr/ebook/9782814507357/musaraignes" round="yes" size="normal" color="blue" flat="no" ]Télécharger le livre[/button]
[divider style="dotted" height="40px" ]
Il vit à Toulon. Son oeuvre narrative est publiée aux éditions de Minuit. Il a beaucoup écrit aussi pour le théâtre, et tient une chronique dans le Matricule des Anges.
Ne manquez pas les autres livres de Jacques Serena,
La Sortante (en collaboration avec Michel Massi)
qui existe aussi en format papier, dans la collection Brefs.